En écrivant le billet sur l’esthétique soft apocalypse dans les jeux vidéo, je me suis souvenu d’un de mes dessins animés préférés quand j’étais enfant : Skyland. Ce n’est pas un chef d’œuvre au succès retentissant, puisque beaucoup dans mon entourage ne le connaissaient pas et que le studio en charge de la réalisation a fermé à l’issue de la première saison. J’en garde pourtant un souvenir tendre et, en replongeant dedans, la musique du générique a ravivé ma joie d’alors.
J’ai voulu comprendre d’où venait cet attachement. Au fil du visionnage des 26 épisodes, une analyse esthético-politique m’a paru plus que pertinente. De ce dessin animé en mauvaise 3D (la tare des pionniers), on peut tirer de précieux enseignements, que l’enfant de 10 ans avait sûrement, même partiellement, identifié et que l’adulte de 29 ans que je suis aujourd’hui veut décupler, comme inspiration d’un imaginaire alternatif formateur aux enjeux politiques, climatiques et technologiques.
Écologie & autonomie

Posons le pitch. Nous sommes au XXVe siècle, et la Terre a littéralement explosé. Des blocs dérivent dans le ciel, quelques petites villes et hameaux survivent à leur surface. Les monuments historiques sont des ruines très soft apocalypse, typiques du romantisme et du trope « réclamé par la nature ». On aperçoit d’ailleurs dans un des épisodes un Paris désert, angoissant, embrumé. La principale conséquence de cet éclatement : l’eau manque. On ne peut que souligner la pertinence de cette série sortie en 2005, qui mobilise un catastrophisme fantastique pour évoquer la raréfaction bien réelle de cette ressource, vingt ans après. Un régime dictatorial, la Sphère, accapare l’eau des pauvres habitants pour remplir ses piscines et se prélasser dans son cocon doré. Difficile de ne pas y voir les polémiques récurrentes (et justifiées) sur la consommation de loisir en période de sécheresse.
Pour asseoir son pouvoir, la Sphère embrigade une certaine élite, les Seijin, qui ont réussi à développer des pouvoirs de télékinésie et télépathie du fait de leur vie céleste (proche du Soleil, dont la lumière alimente cette magie). Le Tutorat forme ainsi une sorte de ministère surpuissant chargé de capturer et de former, aux ordres du régime, tout Seijin dès son enfance. Le contrôle est opéré par ses robots militaires, dans une filiation directe de l’esthétique du Château dans le Ciel de H. Miyazaki (1986). En ressort, au global, une ambiance solarpunk ponctuellement rétrofuturiste, au service d’un discours lui-même très Ghibli : antimilitariste, autarcique, environnementaliste tendance champêtre.

Dans le premier épisode, on découvre les deux personnages principaux, frère et sœur adolescents dont la mère, Seijin d’exception, est capturée par la Sphère. Leur petite communauté a tout pour faire rêver : des arbres majestueux, une pompe éolienne, le calme absolu. L’irruption d’un vaisseau de la dictature et de ses robots vient gâcher la carte postale, dont on comprend rapidement qu’elle ne peut être qu’éphémère au vu de la menace diffuse et constante. Indirectement, c’est donc du fragile équilibre d’un village indépendant dont il est question, étouffé par l’autoritarisme et la rareté des ressources comme les deux faces d’une même pièce. Aussi l’éclatement de la planète n’est-il qu’un ressort métaphorique de l’histoire, une incarnation excentrique du morcellement social et territorial par l’extractivisme guerrier.
Assez logiquement, le motif de la trahison est récurrent. La crise démocratique et écologique fait émerger un « chacun pour soi », réflexe de survie surmonté par la coopération et la ruse. Par exemple, dans l’épisode 8, un des personnages est manipulé par la Sphère afin de créer un conflit dans la population rebelle (en faisant accuser l’héroïne d’avoir détruit les citernes). On comprend donc, même en tant qu’enfant (voire plus clairement ?), que la division et la paranoïa sont les armes clés de la coercition, que la réduction de la vivabilité d’un territoire permet son obéissance, que les boucs émissaires servent toujours un tiers à l’abri des critiques. Le syndrome du sauveur et les plans individuels sont fatalement défaits, l’insoumission ne peut qu’être collective.
Figures de liberté

C’est d’ailleurs la recherche d’ordre après le chaos qui a poussé une partie de la population à se rallier à la Sphère (comme l’avoue le grand-père d’un personnage dans l’épisode 12). Mystiques et scientifiques corrompus incarnent la captation de la sagesse au profit de l’oppressif et du futile, pseudo-choix de raison là aussi facilement assimilable au ralliement fasciste observé aujourd’hui. De l’autre côté, on retrouve tous les stéréotypes de la résistance : le vieux savant dissident, le sévère capitaine, et bien entendu le héros agaçant et imprudent. Si, pour avancer, la série enchaîne laborieusement errements, side stories et autres gaffes sources de micro-péripéties, nous pouvons y voir un choix narratif réfléchi. Chaque quête annexe est une manière d’exposer la complexité de la psyché des personnages, de révéler le gris de la situation, de préférer au manichéisme la confrontation de sentiments irréfléchis. Face au mal, ce n’est pas une lutte organisée et méthodique qui se dessine, mais une somme de personnalités, d’intérêts et d’émotions – ennui, mélancolie, méfiance, orgueil…
Force est de constater que les choix sous contrainte extrême sont confus, et qu’une réponse organisationnelle répressive n’a pas sa place. Notre héros insupportable nous impose d’accepter son tempérament insolent, épris de liberté et d’amusement, comme conséquence naturelle de l’orphelinage et d’un anti-autoritarisme viscéral. Pilote expert, il s’échappe dès que possible, jouant à la course même dans les situations critiques, voulant explorer le monde sans relâche dans un mélange de démonstration de force et de délestage temporaire d’une trop lourde responsabilité.
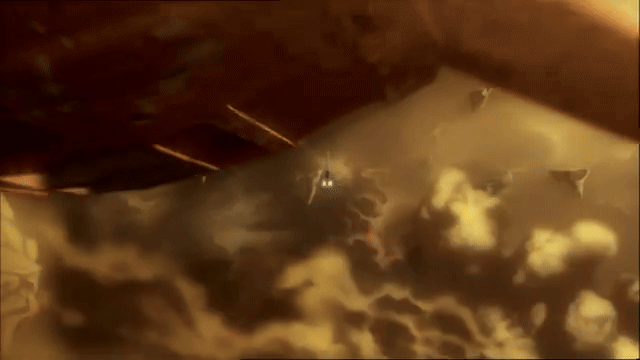
L’univers aérien de Skyland amène donc à une seconde lecture : celle de l’expression d’une liberté malgré tout, autorisée par la navigation fluide ; d’une curiosité inépuisable dans un territoire changeant au gré du vent et donc d’une émancipation par le hors-piste. Je me vois bien en faire une marotte au fil des articles, mais je vais devoir insister. L’entremêlement d’esthétiques dissidentes et d’un appel à la liberté de mouvement constitue à mes yeux un levier crucial de politisation. Skyland expose un monde débarrassé des frontières, tissé comme une mosaïque de communes autonomes et solidaires face à l’adversaire, lié par la circulation du curieux plutôt que par celle des marchandises.
Les Pirates, derniers résistants, parviennent ainsi à écarter la Sphère des Marges, les territoires les plus éloignés du noyau terrestre et donc du contrôle. Ces marges, traitées comme des limbes anxiogènes, forment un sas dangereux et mystérieux vers la ville QG des rebelles qui, elle, flotte dans un ciel bleu apaisant. Difficile de ne pas voir un parallèle avec ce que j’évoquais au sujet d’Hylé II, le récit onirique de Raoul Hausmann de son exil à Ibiza. Les héros de Skyland, comme le dadaïste allemand, restent d’une certaine manière bloqués dans le seuil, condamnés à l’errance malgré les escapades dans un environnement pur. Le réfugié, en dépit d’une liberté de façade dans son refuge, pratique un déplacement contraint, sait que le calme peut cacher une menace, surjoue l’insouciance pour éloigner la nostalgie. Le jamais-ici prend, sur un archipel de blocs terrestres à la dérive, tout son sens ; ces figures de liberté, pirates habiles prêts à explorer sans pouvoir se poser sereinement, révèlent alors l’ambiguïté d’un espace trop ouvert, habitable seulement en mouvement.
Le virtuel, fond et forme
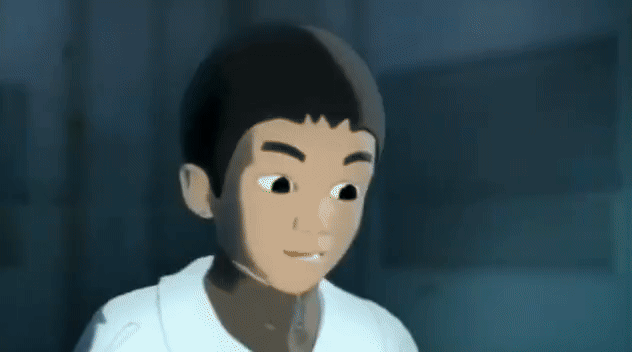
On en vient au troisième axe de réflexion que je souhaitais aborder, et qui viendra creuser un peu plus le rapport entre la forme esthétique de Skyland et son fond politico-philosophique. La série est une ode à la navigation, à un mouvement constant des lieux et des personnes empêchant toute cartographie définitive. Chez Vitali-Rosati, que j’ai déjà cité dans mon précédant post et que je prolonge ici d’un exemple un peu détonnant, on retrouve une analyse poussée de la navigation marine. En mer, comme dans le ciel, on est partout et nulle part à la fois : partout car dans l’espace qui relie tous les autres, nulle part car l’absence de repère fixe désoriente (fait perdre la direction de l’orient). Certes, des coordonnées sont identifiables scientifiquement, mais il ne s’agit que d’une abstraction temporaire, décorrélée du mouvement et sans pouvoir sur le ressenti de déterritorialisation.
Ce terme, forgé par Deleuze et Guattari, désigne un processus par lequel une habitude (de pensée ou d’action) se défait de son ancrage (spatial ou symbolique). La déterritorialisation n’induit pas une disparition de l’espace (d’origine, ou de la notion même), mais décrit un mouvement, un affranchissement souvent en prémisse d’une reterritorialisation. L’éclatement de la Terre dans Skyland représente donc aussi bien le modelage subjectif, par une exploration sans fin, d’un monde vécu lui-même mouvant, que l’attachement fatal de l’individu à un bloc donné, devant surmonter sa tristesse quand il doit le fuir ou, à l’inverse, sa curiosité risquée pour l’ailleurs.

Ce qui me semble pertinent ici, c’est que Vitali-Rosati associe la déterritorialisation du marin au sentiment de naviguer dans un espace virtuel. Dans un monde virtuel (en ligne ou immersif), l’individu n’est pas « hors du réel » : son corps comme les technologies productrices du monde sont parfaitement localisables, mais son ici est multiple et mouvant. Comme la mer, l’espace virtuel donne l’impression simultanée d’un partout (reliant une infinité de lieux) et d’un nulle part (double présence perturbante du corps physique et du corps virtuel). Le monde pratiqué, généré au gré de ses choix de navigation, est donc irréductible à une carte définitive. Le choix d’une histoire de pirates parcourant le ciel dans un monde éclaté et évolutif et celui d’un style 3D affirmé ne font ainsi, à mon sens, qu’un.
L’animation 3D comme œuvre de pureté technologique, d’un faire futur explicite, est typique des années 2000. Le virtuel doit alors inspirer un avenir ouvert, où tout circule, où l’expression individuelle se défait de toute entrave. Un enthousiasme débridé, qui a donné le Frutiger Aero dont on reconnait, dans Skyland, la dominante bleu/vert (ciel/gazon) et l’aérien (transparence, brume, lignes de mouvement). En plus du principe 3D, la mobilisation de nouveaux procédés d’éclairage, le mélange entre dessin à la main et motion design ou encore la présence d’hologrammes sont autant de leviers mobilisés pour crédibiliser la proposition du futur porté par l’histoire. Un futur menacé par la crise environnementale et le totalitarisme, mais aussi (et peut-être avant tout) libéré par la force du virtuel.

Résumons. Skyland est une fable écologiste dont la métaphore de l’éclatement de la planète n’est que la toile fantasque d’un propos pédagogique. Celui-ci associe explicitement perte de vivabilité et dérives autocratiques, avec toute la complexité politique induite : trahisons, hésitations émotionnelles, choix sous contrainte. La réponse prônée est certes une résistance collective, mais sans jamais brider l’aspiration immédiate à la liberté. On comprend que les Marges, délaissées par le pouvoir, sont les seuls espaces où exprimer ce besoin d’explorer, mais également que les marginaux, des exilés bloqués dans le seuil, s’échappent sans cesse à défaut de pouvoir se poser. Un mouvement à interpréter comme une forme de déterritorialisation induite par l’éclatement, puisque le monde n’est désormais plus cartographiable et ne peut donc garantir d’ici habitable durablement.
Surtout, la navigation aérienne autorise une ouverture similaire au virtuel des nouvelles technologies (rencontrer sans se déplacer, explorer une infinité de lieux, expérimenter). C’est ainsi que les codes graphiques futuristes pour l’époque, loin d’être une coquetterie, favorisent la projection dans cet avenir très réaliste et associent fermement multiplicité libératrice du virtuel et aspirations matérielles à l’émancipation. J’y vois en ce sens, et dans la mesure où il ne s’agit que d’un petit dessin animé, une bribe d’anticapitalisme imaginaire, un élément de représentation esthétique véhiculant intuitivement, dans le fond comme dans la forme, de valeurs de rupture.


Répondre à coastal metropolis : analyse d’une anemoia géographique – out_liminal Annuler la réponse.