article 1/3 de la série « Les esthétiques perdues des jeux-vidéos »
Enfant, j’ai suivi au gré des cadeaux l’histoire des consoles de jeu : Game Boy Color, PS2, Nintendo DS, Wii, Xbox 360. Mais si une seule devait résumer l’ensemble des souvenirs, sensations et images de cette époque, ce serait sans conteste la GameCube. Assis sur le lino, à deux mètres de la télé cathodique, je vois défiler les paysages 3D de Super Mario Sunshine, Mario Kart : Double Dash!!, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore Final Fantasy Crystal Chronicles. Je découvre et j’explore des mondes scintillants, apaisants, peuplés d’une faune fantasque et d’une flore luxuriante.
Un même écosystème me séduit : la plage tropicale, avec ses palmiers et ses dauphins, son petit village, ses nuages géants et sa mosaïque de lumière à la surface de l’eau. Mélange de prouesse technologique et de poésie discrète, la tropical map est devenue un marqueur du dépaysement par l’écran – pour moi, pour beaucoup. Subreddits, articles et reels se sont déjà penchés sur ce vécu partagé pour en chercher l’origine : pourquoi autant de jeux des années 2000 ont adopté, et diffusé, cette esthétique ? Pourquoi voit-on moins de douceur tropicale dans les jeux vidéo d’aujourd’hui ? Et comment retrouver ce sentiment d’ailleurs si doux ?
Faire rêver parce que l’on peut
Commençons par la première question. Au tournant du millénaire, la concurrence entre Nintendo, Sony et Microsoft fait rage, et les avancées techniques sont plus en plus rapides et massives. Parmi les tours de force à réaliser pour affirmer sa supériorité, le réalisme de l’eau est un incontournable. Le défi est complexe : créer un effet de profondeur en transparence, un mouvement fluide et naturel, un traitement des ombres et des reflets, des éclaboussures cohérentes avec le déplacement. Ajoutez des mouettes, des animaux marins et des bateaux pilotables sur une texture aussi exigeante, et vous avez le modèle-type du chef d’œuvre informatique et artistique de l’époque.
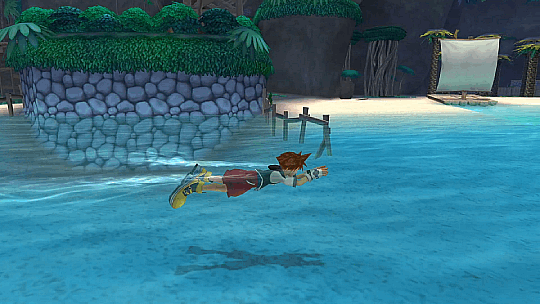
Il faut dire que les possibilités graphiques ouvertes au tournant du millénaire sont un soulagement. Les jeux des années 1990 étaient encore contraints à des maps lisses et rigides pour éviter tout bug ou excès de data. De nouveaux outils 3D ont permis davantage de transparence et de subtilité dans le rendu des couleurs. En revanche, la performance encore limitée des moteurs de jeu obligeait à préférer les environnements extérieurs très lumineux, plutôt que les intérieurs surchargés. La plage tropicale, composée d’étendues simples de ciel, de sable et d’eau, semblait alors la meilleure option. Cette ère technologique intermédiaire – meilleur rendu des textures mais limitation du niveau de détail – correspond à une esthétique plus immersive qu’hyperréaliste. Il va sans dire qu’à mesure des innovations, c’est le réalisme extrême qui a primé, toujours dans une logique de démonstration de force. Le toujours-ensoleillé et le dépouillé n’ont désormais plus besoin d’être.
Il ne s’agit toutefois pas que d’un hasard technique. La décennie d’avant avait produit de nombreux objets culturels vecteurs d’une esthétique balnéaire : Point Break, Alerte à Malibu, Sauvez Willy, les chansons des Red Hot Chili Peppers et d’Israel Kamakawiwoʻole. Les années 1990 sont aussi celles où l’Amérique chérit de nouveau le beach party film des années 1960 (Warshaw, 2003), première pierre de la nostalgie pour la douceur californienne. Enfin, Okinawa est à cette époque une destination promue à l’international tandis qu’Hawaii redoublait de communication notamment au Japon, un va-et-vient d’attractivité touristique entre les deux pays leaders du jeu vidéo. Surfer, bronzer, partir sous les tropiques représentait pour beaucoup (dont les développeurs) la quintessence des vacances et du dépaysement. Après la diffusion médiatique du « vrai paradis », sa sublimation digitale.

La faisabilité technique d’une eau « qui donne envie de s’y plonger » a donc favorisé un élan exotique. Comme tout phénomène de mode et de concurrence, les premières réalisations probantes ont déclenché un véritable déferlement de jeux tropicaux entre 1998 (Sonic Adventure) et 2002 (Kingdom Hearts, GTA Vice City mais aussi le film Lilo & Stitch). Après avoir constaté qu’aucun bug de l’an 2000 n’est survenu, l’Occident était encore capable d’optimisme, louant la victoire mondiale du libéralisme, s’autorisant à croire en une douceur vacancière. Le tourisme lointain se généralise, Google Maps n’existe pas encore, les tropiques sont toujours un rêve.
La disparition du mythe vacancier
À cette époque, l’ailleurs était ensoleillé, paisible, encore préservé de la mondialisation qui l’a pourtant rendu accessible. Au fil des années 2000, d’autres représentations de cet ailleurs, chargées politiquement post-11-Septembre, se sont imposées. D’une part, les guerres américaines au Moyen-Orient, inondant les médias de paysages arides et montagneux dont les principales franchises de FPS se sont inspirées. D’autre part, l’affirmation de la Chine comme grande puissance, avec ses immeubles sordides à perte de vue et ses immenses usines, vectrice d’une esthétique dystopique propice au nouveau réalisme du jeu vidéo. Cette décennie est aussi celle où l’on prend globalement – mais lentement – conscience du changement climatique, du risque de submersion de pays insulaires, de la disparition de la Grande Barrière de Corail, des méga-ouragans, de la déforestation. Le tropical est menacé, son imaginaire est donc souillé.

Pour se risquer à une hypothèse, les paysages tropicaux paradisiaques des jeux vidéo de l’enfance auraient été le chant du cygne d’un enthousiasme pré-troisième-millénaire. Le jeu vidéo et la technologie dans son ensemble se posaient encore en alternative onirique : les mondes virtuels n’étaient pas aussi crédibles que le vrai, mais ils étaient ouverts, simples, archétypaux. Ils rendaient possibles l’idéal. Aussi, l’industrie vidéoludique pouvait être un terrain de fantaisie, d’expérimentation innocente (le manque d’émergence de nouvelles franchises aujourd’hui en est la désillusion). Pour toutes celles et tous ceux qui ne vivaient pas sur la côte et qui partaient rarement en vacances, les jeux tropicaux constituaient une adorable porte de sortie. La meilleure manière de s’échapper et de découvrir un ailleurs authentiquement dépaysant était d’allumer sa console – cela a-t-il changé ?
Surtout, les réseaux sociaux n’avaient pas encore diffusé massivement des photos de plages immaculées, parfaitement retouchées. Aller à Bali ou à Dubaï, comme le vantent influenceurs et digital nomads, ne relevait pas de l’évidence CSP+. La seconde moitié du XXe siècle, depuis la vague bossa nova, avait entretenu un tropicalisme guilleret, des campagnes publicitaires du Club Med aux développements des destinations de spring break. Il s’agissait de réaliser, de façon marchande bien sûr, un mythe. Une fois commercialisé, le mythe s’affadit, et il faut chercher d’autres impossibles. La station balnéaire démythifiée révèle alors, dans sa ringardise, ce que l’on ne voulait pas voir : une dimension populaire et consumériste qui fait mauvais genre. Reproduire l’idéal-type des vacances, ce serait, in fine, ne rien comprendre : « mais tout le monde l’a fait, c’est vu et revu ! »

La douceur, ni ici, ni ailleurs
L’oisiveté n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté. La doctrine du « goût du travail » l’a emporté, les pays capitalistes ne peuvent plus compter sur le progrès technologique pour couler des jours heureux et calmes, de surcroît sur des plages caniculaires, surpeuplées et polluées. Mario ne saura pas les débarrasser de la boue toxique comme sur l’île Delfino, car elle est ici invisible : c’est la boue du fatalisme, celle qui réduit la côte tropicale à un truc à faire, sans l’enchantement pour le lointain qui donne aux enfants (des familles précaires) l’envie d’être adulte pour partir. Au contraire, le virtuel contemporain est envahi d’injonctions sociales et de vidéos IA montrant tout ce qui aurait pu être – et qui fut tué dans l’œuf par la dérive techno-capitaliste.
Mais cette lente annulation du tropical (pour paraphraser Fisher) n’est pas qu’une affaire d’ailleurs. Il faut se souvenir, avec une pointe assumée de nostalgie, que durant les années 1990 et 2000, le dépaysement balnéaire était partout dans notre quotidien. Savon Palmolive aux poissons bariolés, fonds d’écran et décorations aquatiques, publicités pour Ushuaïa ou Kodak… Ces représentations d’une nature douce et immaculée, d’un avenir aussi technologique qu’écologique, sont en réalité le sous-genre vacancier d’une esthétique dominante alors, dénommée a posteriori Frutiger Aero. Regretter les plages virtuelles de l’enfance, ce n’est pas simplement faire le deuil d’une mythification occidentale des tropiques : il y a bien eu une disparition progressive des représentations quotidiennes d’un possible ensoleillé.

L’esthétique Frutiger Aero se reconnait à ces ciels profonds, du glossy et du translucide, un soleil éblouissant illuminant villes et pelouses, et une technologie rafraîchissante. Le début du millénaire connait alors une invasion de photos de paysages apaisants, morceaux de nature qui visent à humaniser l’interface mais dont la perfection numérique est irrémédiablement associée à une forme de promesse utopique : l’ordinateur sublime la nature. Du bleu, du vert, un mélange de liquid glass (le verre des gratte-ciels comme marqueur de futur) et de couleurs saturées, un bain de lumière apporté à l’univers encore austère de l’informatique. C’est aussi l’époque des villes du futur, mondes flottants, végétalisés, baignés d’air pur alors que la décarbonation arrive dans le débat. En somme, le futur désirable est ensoleillé et sain, grâce et avec la technologie de pointe. Le doute n’a pas tardé à arriver et les Big Tech ont alors opté pour quelque chose de plus « sérieux » – un lent désengagement vis-à-vis de la planète. En 2016, le dark mode fait son apparition, les formes géométriques rigides prenaient déjà la relève de cette brève phase de rondeur et de douceur dans la sphère technologique.
Il y avait une époque où les univers virtuels incarnaient une échappatoire devant l’angoisse du monde réel, et durant cette même époque le design d’objets du quotidien prolongeait cette rêverie. Sans doute nos sociétés voyaient-elles dans le bouleversement informatique une occasion de davantage de couleur et de joie. Une simple lampe aux poissons exotiques, incarnation familière du Frutiger Aero et de sa variante tropicale, peut agir en rappel amer : « This was our escape. »

Moins de 10 ans après la sortie de Super Mario Sunshine, la vague seapunk s’apprêtait à déferler sur l’Internet créatif et bloggeur. Sorte de célébration hallucinée des dauphins et de l’eau en 3D, on retrouve aisément dans toute création seapunk les traces de Miami Vice, de Waterworld, de GTA ou encore, évidemment, d’Ecco The Dolphin. Les bruits de mouette qui ponctuent la musique associée sont ceux des jeux vidéo, puisque c’est la mer digitale, générée et sublimée par ordinateur, qui est louée. En ressort une impression d’ironie dans le deuil, une nostalgie reconstruite de la dernière vingtaine du XXe siècle, qui surgit presque immédiatement après la prise de conscience de la disparition. L’esthétique Surf Crush, qui poursuit péniblement la décennie après 2002 au travers de séries adolescentes comme H2O ou Laguna Beach, n’aura pas su entretenir la flamme pour le mythe de la plage tropicale : c’est au contraire un éloge de la jeunesse blanche aisée, d’un Californian way-of-life aseptisé et beaucoup trop familier pour donner goût à l’ailleurs édénique. Le seapunk vient clore cette mascarade, ce détournement américano-centré, pour affirmer que le tropical de nos jeux d’enfant est bel et bien mort, et définitivement virtuel (à l’état de possible, non réalisé).
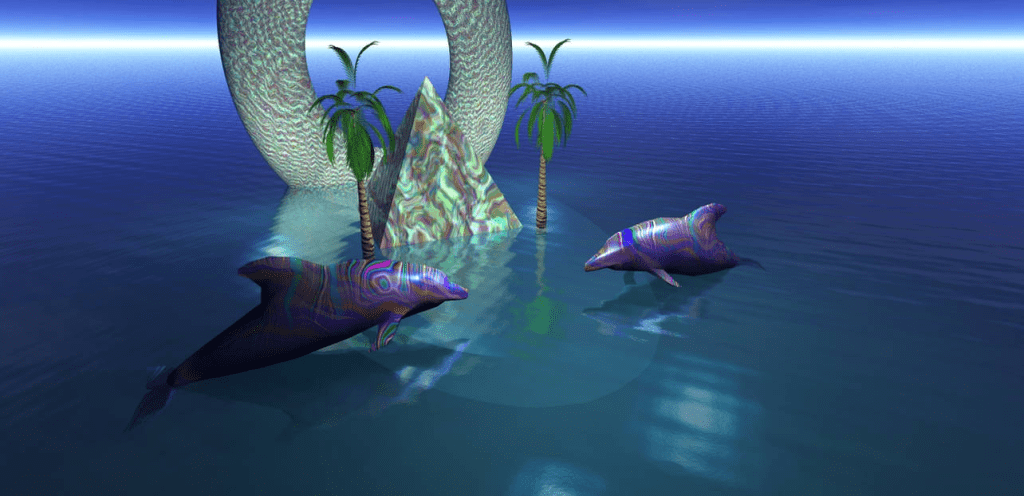
Désormais adulte, mon goût pour les palmiers, les gratte-ciels de bord de mer et les mouettes n’a pas disparu, loin de là. On peut retrouver aux Canaries, dans quelques stations balnéaires un peu démodées, des bribes de ce rêve tropical. Mais pour étancher la soif de dépaysement que la 3D brute de la GameCube suscitait chez l’enfant de la campagne, un retour aux écrans, par le truchement de reels aquatiques et ensoleillés, est indispensable, quoiqu’aigre-doux.
—
Matt Warshaw, The Encyclopedia of Surfing, Orlando, Harcourt Books, 2003


Répondre à coastal metropolis : analyse d’une anemoia géographique – out_liminal Annuler la réponse.